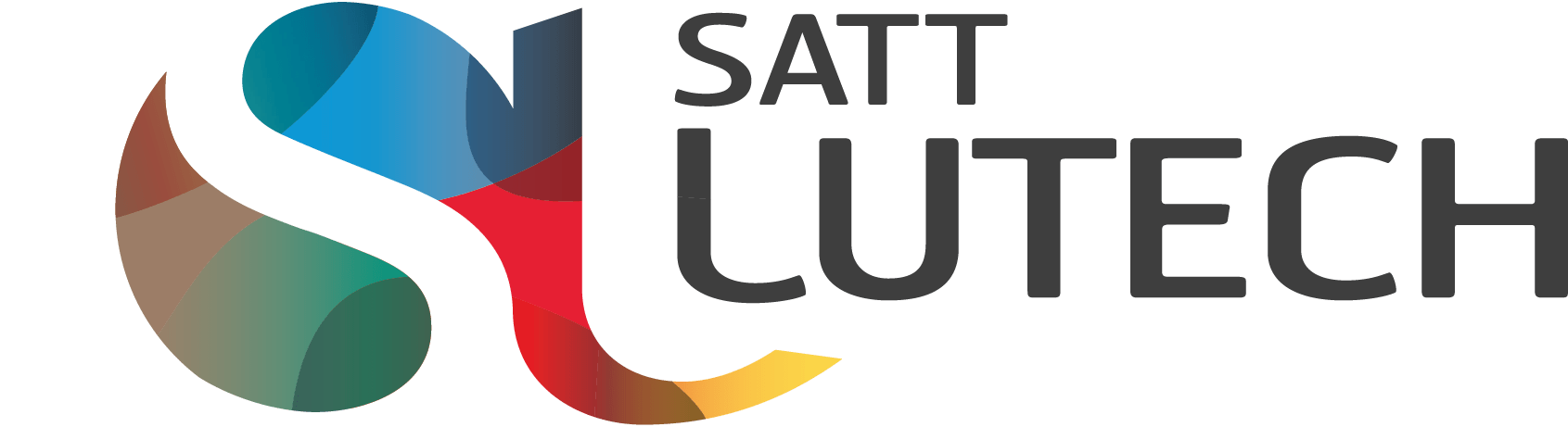Parmi les rétinopathies, qui désignent les affections de la rétines, la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), est la première cause de handicap visuel chez les personnes de plus de 50 ans. A ce jour il n’existe pas de traitement curatif satisfaisant de cette affection et les prescriptions visent essentiellement à limiter la progression de la maladie dans le cas de la DMLA humide. Cette forme de la maladie se caractérise par une prolifération de nouveaux vaisseaux sous la rétine qui conduisent notamment à son soulèvement et à des hémorragies rétiniennes. Les personnes atteintes subissent une perte progressive de leur vision centrale.
La thérapie cellulaire est l’une des pistes explorée pour traiter ces pathologies : c’est au Japon, en 2017, qu’un patient, dans le cadre d’une étude clinique de phase 1, a pour la première fois reçu une greffe de cellules de la rétine obtenues à partir de cellules souches d’un donneur >> VOIR L’ARTICLE.
Quelques années plus tôt une opération de greffe autologue d’un feuillet de cellules d’épithélium pigmentaires rétinien (EPR) différenciées avait été réalisée, elle avait déjà permis une légère diminution des symptômes chez la patiente.
L’une des problématiques de la greffe de cellules EPR correspond aux phénomènes de différenciation incomplète (i.e. les cellules n’ayant pas atteint un niveau de maturation nécessaire pour être fonctionnelles ) ou de dédifférenciation (i.e. les cellules perdent certains caractères de différenciation cellulaire après la greffe et ne peuvent plus remplir leur rôle au sein de la rétine) qui limitent l’amélioration de la vision. L’équipe de Thierry Léveillard, Directeur de Recherche INSERM, au sein de l’Institut de la Vision (UPMC/CNRS/INSERM) a mis en évidence une corrélation entre l’expression du facteur de transcription (* ) OTX2 (**) et la différenciation des cellules d’intérêt. Les travaux qui ont été menés à partir de ce constat ont conduit au développement d’une nouvelle technologie brevetée qui permet la surexpression d’OTX2 dans des cellules EPR. Ces cellules modifiées, obtenues à partir de cellules souches pluripotentes (iPS) animales altérée par un processus viral, une fois implantées, ne se dédifférencient pas, et la survie des photorécepteurs, qui sont au contact des cellules EPR qui produisent des facteurs de croissance favorisant la survie des photorécepteurs et participent au recyclage de ces derniers ), est améliorée.
Cette avancée technologique devrait très nettement améliorer l’obtention de cellules ERP à implanter et favoriser la restauration de la vision des patients après une transplantation. Considérant le potentiel de ce projet et les perspectives de développement, Lutech s’est associée à l’équipe pour mettre en place un programme de maturation visant notamment à réaliser des transplantations de ces nouvelles cellules dans un modèle animal ainsi qu’à la pertinence de la technologie sur des cellules d’origine humaines. In fine, il s’agira d’obtenir une preuve de concept in vivo. La technologie développée devrait éveillée l’intérêt des acteurs de la thérapie cellulaire en ophtalmologie.
Retrouvez ici le séminaire de Thierry Léveillard au Collège de France à propos de la prévention de la cécité réalisé dans le contexte de la chaire Innovation technologique Liliane Bettencourt occupée en 2015-2016 par José-Alain Sahel.
(*) Les facteurs de transcription sont des molécules qui régulent l’expression de gènes par les organismes
(**) Kole, Christo, Laurence Klipfel, Ying Yang, Vanessa Ferracane, Frederic Blond, Sacha Reichman, Géraldine Millet-Puel, Emmanuelle Clérin, Najate Aït-Ali, Delphine Pagan, Hawa Camara, Marie-Noëlle Delyfer, Emeline F. Nandrot, Jose-Alain Sahel, Olivier Goureau, and Thierry Léveillard. « Otx2 -Genetically Modified Retinal Pigment Epithelial Cells Rescue Photoreceptors after Transplantation. » Molecular Therapy, 2017. doi:10.1016/j.ymthe.2017.09.007 (Through ).
Nous avons sollicité Thiery Léveillard afin qu’il nous parle de l’avancement du projet. Il nous a tout d’abord indiqué que le projet avait été initié à l’occasion d’une réponse à un appel d’offre ouvert et qu’une demande de brevet avait été déposée au préalable pour protéger les résultats obtenus par le laboratoire. Il a précisé que l’Institut de la Vision étant sous la tutelle de l’UPMC, il était naturel de s’adresser à la cellule de valorisation de l’UPMC, la DGRTT, qui travaille en étroite collaboration avec Lutech. Il nous a indiqué que la phase de preuve de concept chez l’animal avec des cellules pouvant servir dans le futur d’agent thérapeutique était en cours de réalisation.
Lorsque nous l’avons interrogé sur la manière dont il collaborait avec les entreprises il nous a tout d’abord fait part de son implication dans la création de la start-up SparingVision en juin 2016 et a également souligné l’optimisme avec lequel il abordait les collaborations. Il a précisé par ailleurs que le laboratoire développait des innovations qui ne pouvaient être transférées en pratique médicale sans le concours d’un industriel.
Nous avons demandé à Laurent David, chef de projet associé au programme de maturation, de nous parler des programmes dans le secteur thérapeutique.
[Laurent David] Quels types de résultats sont nécessaires pour construire un programme de maturation avec Lutech ?
Pour monter un programme de maturation, les projets sélectionnés doivent présenter un fort potentiel de valorisation mais également reposer sur des résultats préalables concrets, permettant de démontrer l’atteinte, a minima, d’une « preuve de concept » académique. Le but étant, au terme de la maturation par Lutech, d’atteindre une maturité technologique suffisante pour permettre la signature d’une licence avec un partenaire industriel ou développer une start-up créée sur la base de l’invention.
Hormis les résultats scientifiques, les éléments de comparaison tant techniques que « marché » sont des éléments clés d’analyse pour envisager le montage d’un programme de maturation. Ils permettent de positionner la solution par rapport aux technologies existantes et d’évaluer sa potentielle prise de parts de marché.
D’autres éléments peuvent y être associés tels que la protection des résultats par la propriété intellectuelle (e.g. brevet ou savoir-faire) ou l’identification en amont de partenaires industriels (co-maturation).
[Laurent David] Quelles sont les étapes de développement à réaliser l’issue d’un programme de maturation dans le domaine thérapeutique pour qu’un produit atteigne le marché ?
En fin de maturation, une technologie dans le domaine thérapeutique a été consolidée et a atteint en général une preuve de concept préclinique in vitro et in vivo (dans des modèles animaux).
La mise sur le marché d’une nouvelle molécule thérapeutique arrivera en conclusion d’une suite de phases de recherche et d’analyse permettant de déterminer le plus finement possible l’efficacité et la tolérance du futur médicament. Il faut savoir que pour une molécule arrivant sur le marché, plusieurs milliers de molécules ont été éliminées lors des différentes étapes de développement R&D.
En post-maturation, la molécule thérapeutique devra subir un grand nombre de tests codifiés d’un point de vue réglementaire qui serviront à constituer le dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) aux autorités de santé.
Deux grandes étapes successives interviennent après la maturation:
- Le développement préclinique réglementaire permet d’obtenir les premières informations sur le comportement d’un médicament, indispensable avant les essais chez l’homme. Ces expérimentations sont principalement menées sur l’animal. Au cours de ce développement est ainsi déterminé le profil pharmacologique, pharmacocinétique (comportement et devenir du composé dans un organisme vivant) et toxicologique (organes cibles et doses toxiques) de la molécule thérapeutique, ce qui permettra de fixer les doses et les voies d’administration chez l’homme.
- Le développement clinique qui est l’étude du médicament chez des populations de personnes atteintes ou non de la maladie, dans le but de démontrer son efficacité thérapeutique. Ces études sont initiées à la fois par les entreprises qui développent de nouveaux médicaments et par des équipes académiques. Elles se font en phases successives, (i) la phase 1 a pour objectif d’étudier la tolérance et le devenir dans l’organisme du médicament chez des volontaires sains, en petits effectifs, (ii) la phase 2 fera ressortir la dose optimale en terme d’efficacité et de tolérance chez un petit nombre de personnes malades et (iii) la phase 3 évaluera le rapport bénéfice/risque (effets secondaires) chez un grand nombre de volontaires. Le médicament sera également comparé aux traitements de référence de la maladie.
Une fois ces études validées, l’ensemble des données va constituer le dossier d’AMM déposé auprès des autorités sanitaires françaises (ANSM) ou européennes (EMA). Avec cette autorisation, un médicament peut alors arriver sur le marché.